
Introduite en 2019 par la loi n° 2019-759, la taxe GAFA s’applique aux entreprises numériques générant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et au moins 25 millions en France. Elle cible les revenus issus de la mise en relation via des interfaces numériques, de la publicité ciblée, ainsi que de la revente de données à des fins publicitaires.
La société requérante (une filiale du groupe allemand Axel Springer qui possède notamment SeLoger et MeilleursAgents), ainsi que d’autres entreprises comme Airbnb et Le Bon Coin, contestaient la conformité de plusieurs dispositions légales, en invoquant notamment une atteinte aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant les charges publiques, et à la liberté d’entreprendre.
Elles estimaient que la taxe instaurait des différences de traitement injustifiées entre entreprises, en fonction de leur appartenance à un groupe, de leur implantation géographique, ou de la nature numérique ou non de leurs services.
Des critères jugés objectifs et rationnels
Le Conseil constitutionnel a considéré que la taxe poursuit un objectif clair : générer des recettes fiscales en ciblant des services numériques dont la création de valeur repose en grande partie sur l’activité des utilisateurs situés en France.
Le choix d’imposer uniquement certains services numériques (interfaces de mise en relation, publicité ciblée) et d’en exclure d’autres (contenus numériques, services de paiement ou de communication) a été jugé cohérent. Le Conseil a estimé que le législateur s’était fondé sur des critères « objectifs et rationnels » en lien direct avec le but recherché : un rendement budgétaire significatif.
Les seuils d’imposition et la territorialité également validés
Les juges constitutionnels ont aussi entériné l’appréciation des seuils de 750 millions d’euros à l’échelle mondiale et de 25 millions en France, y compris au niveau consolidé pour les groupes d’entreprises. Cette méthode, contestée pour sa prétendue irrationalité, vise selon eux à éviter un morcellement artificiel des activités numériques.
Quant aux règles de territorialité fondées sur la localisation des utilisateurs via des comptes ouverts depuis la France ou des connexions identifiées en France, elles ont été jugées adaptées à la nature dématérialisée des services taxés. Le Conseil a estimé qu’elles ne méconnaissent ni la capacité contributive des redevables, ni les principes d’égalité.
Aucun caractère confiscatoire
Le taux unique de 3 % sur le chiffre d’affaires, sans progressivité ni mécanisme de lissage, ne constitue pas pour autant une atteinte excessive aux facultés contributives, a tranché le Conseil. Il a souligné que la taxe porte sur des encaissements liés à des services précis et qu’elle s’applique de manière identique à toutes les entreprises concernées, quel que soit leur pays d’établissement.
Une mesure désormais consolidée
Enfin, les modalités spécifiques de calcul pour l’année 2019, période de transition lors de l’entrée en vigueur de la taxe, ont également été jugées conformes à la Constitution. Le législateur a, selon le Conseil, pris en compte les contraintes techniques auxquelles faisaient face les entreprises lors de la première année d’application.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel clôt un contentieux de longue haleine, renforçant la légitimité d’un dispositif qui reste un pilier de la fiscalité numérique en France. Selon Le Monde, la taxe rapportera 774 millions d’euros en 2025.








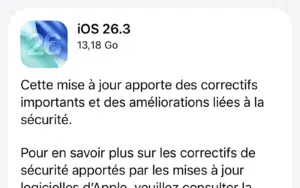


Soyez le premier à poster un commentaire
Partagez votre avis et participez à la discussion en laissant un commentaire ci-contre.